Il y a quelque chose de Nietzsche chez Julien Gracq
Article publié sur le site de Bibliobs : https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20210120.OBS39129/julien-gracq-ce-prophete-d-outre-tombe-qui-raconte-notre-monde-post-covid.html
Il y a quelque chose de Nietzsche chez Julien Gracq. L’auteur des Considérations inactuelles n’aurait pas boudé ces Nœuds de vie qui, bien que posthumes, n’ont rien de l’aspect tombés-du-camion qui caractérise trop souvent les fragments publiés sans le consentement des tombeaux. Et pourtant, Julien Gracq – comme on pourra le lire dans ce volume qui vient de paraître – ne s’attendait pas à être lu en 2021, contrairement à son héros, Stendhal, lequel pariait sur 1935 et la postérité, se fichant éperdument – happy few mis à part – de ses contemporains. « Je ne mets guère mon espoir, comme on pouvait le faire encore au dernier siècle, à être lu en l’an 2000 ou 2010 », écrit Gracq en réponse à un critique humaniste qui lui reprochait le « désert humain » de ses Lettrines II.
Ce qui frappe au premier coup d’œil le lecteur, dans ces fragments sauvés de l’oubli, c’est l’absence de dates, comme si l’époque n’avait que peu de prise sur la sensibilité d’un homme, la physionomie d’un paysage et l’ordonnancement d’une œuvre qui avait abandonné depuis la fin des années 60 tout souci de l’intrigue : la dernière véritable fiction achevée par Julien Gracq fut Le Roi Cophetua, une des nouvelles composant le recueil de La Presqu’île, paru en 1970. Ensuite, Gracq consacra toute sa vie à écrire des fragments – milliers de pages des lettrines ou notules, selon ses propres termes – dont les quelques volumes publiés de son vivant ne constituent que la partie émergée de l’iceberg. On y trouve – pêle-mêle – des considérations géographiques, météorologiques, historiques, littéraires. La pointe la plus aiguisée de l’iceberg Gracq ne nous sera révélée qu’à partir de 2027 : ce sont toutes les pages croustillantes où le pamphlétaire de La littérature à l’estomac égratigne ses contemporains. Mais nous avons la chance grâce à Bernhild Boie, son exécutrice testamentaire, épaulée par Bertrand Fillaudeau, le fidèle éditeur de la maison créée par José Corti, et par Jérôme Villeminoz, conservateur du fonds Gracq à la BNF, de pouvoir lire aujourd’hui ces Nœuds de vie, sortes de Lettrines III qui rassemblent les considérations intempestives de celui qui passe encore pour un ermite confiné dans sa tour d’ivoire alors que tout indique qu’il voyageait beaucoup et qu’il fréquentait les musées, les expositions, les cinémas, les théâtres, et même parfois – mais point trop n’en faut – ses congénères.
En 164 pages d’une grande exigence stylistique qui se lisent sans coupe-papier mais où la plume a souvent le tranchant d’un sabre, Gracq s’y montre tour à tour géographe, géologue, météorologue, commentateur du temps qu’il fait comme du temps qui passe, historien, sociologue, philosophe, musicologue, amateur d’art ou critique littéraire. Afin de mieux guider le lecteur dans cette forêt touffue de signes et de balises, Bernhild Boie a repris partiellement la nomenclature des Lettrines en réunissant les fragments sous quatre chapeaux : chemins et rues, instants, lire, écrire, nous confirmant que, sur l’iceberg Gracq la géographie précède toujours l’histoire, tandis que l’acte d’écrire ne vient jamais que prolonger celui de lire – lorsqu’on lui demandait ses raisons d’écrire, l’auteur répondait « parce que d’autres l’ont fait avant moi ».
Chaque rubrique est introduite par une photographie – issue des archives de l’auteur – qui vient nous rappeler que derrière l’œil du géographe se tapit l’œil d’un photographe : sa vie durant, Gracq a photographié des paysages, si bien qu’une exposition dévoilera bientôt ce travail encore méconnu. À trop considérer la place éminente du romancier dans l’histoire de la littérature française – la publication posthume en 2014 des Terres du couchant, récit inachevé, ravivait les sortilèges du Rivage des Syrtes – nous avions fini par oublier le mordant de l’essayiste. C’est donc avec plaisir que nous retrouvons ici la vigueur et la férocité du plus grand ruminant de la littérature française : Gracq se nourrit de tout, c’est un esprit libre et encyclopédiste, d’une curiosité insatiable, et, même s’il fustige la croyance dans la possibilité de retranscrire le parlé en littérature, on a pourtant l’impression – à lire treize ans après sa mort ces pages comme sorties du frigo – qu’il est encore là, à côté de nous, et qu’il nous parle en écrivant, comme un Ancien à qui l’on serait venu rendre visite pour prendre un peu de la graine : « Hé non, il ne le peut pas, il ne le voudra jamais, s’il est vrai que le beau est d’abord ce qui désoriente, que la littérature commence à se porter un peu mieux quand la critique commence à s’y reconnaître un peu moins – que l’écrivain digne de ce nom est une générosité intempestive, une fraternité qui ne marche pas en rang, une aventure qui se passe du coude à coude, et une liberté qui n’adhère jamais. »
L’avantage de ne jamais dater ses réflexions, c’est que dans ces cogitations d’outre-tombe, on a l’impression parfois qu’un prophète nous parle de notre monde post-covid et des errances de ceux qui nous gouvernent, comme on avait l’impression, en 2014, que les Terres du couchant, où l’on entendait tomber les têtes, se passaient sous Daech, du côté de Raqqa : « la Terre a perdu sa solidité et son assise, cette colline, aujourd’hui, on peut la raser à volonté, ce fleuve l’assécher, ces nuages les dissoudre. Le moment approche où l’homme n’aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu’un monde entièrement refait de sa main à son idée – et je doute qu’à ce moment il puisse se reposer pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre était bonne. » Et, quelques pages plus loin : « La terreur des âges obscurs revient. C’est la terreur, non plus des forces démoniaques, mais de l’État vampire, de la puissance politique à tout jamais déshumanisée « comme un œil de veau dans la nuit », des œillères sur les paupières, (on serait tenté d’ajouter « un masque sur la bouche »), un gourdin à la main, une sébile de l’autre, sorte d’ogre obscène et terrifiant qui titube au milieu d’un immense troupeau d’hommes nus. »
C’est du Gracq trempé dans du Kafka que nous découvrons parfois ici, au détour d’une de ces pages écrites à la manière noire, et toute tentative de le récupérer d’un côté ou de l’autre, serait vouée à l’échec, car, dans ce coq à l’âne permanent, il raille aussi bien « nos jérémiades écologiques » que nos bonimenteurs de la Révolution ou notre « stase post-coloniale ». Julien Gracq est l’irrécupérable par excellence : comme il le note lui-même, en se moquant de tout et d’abord de lui-même, « survivance folklorique », il n’a pas eu de confrères, il ne pouvait donc pas avoir d’héritiers ou de descendants. Régis Debray, qui le place au pinacle du XXe siècle, ronchonnera sans doute en voyant ici Victor Hugo raillé (« une forme évacuée de la grandeur, sans pouvoir sur les esprits et les cœurs »), Paul Valéry moqué (« le colosse de la pensée pour album ») et Stendhal adulé (« le moins physiquement mort de tous les écrivains du passé »). Pierre Michon et Pierre Bergounioux, qui lui doivent tant, seraient étonnés de le voir disserter là sur les graffitis des pissotières plutôt que sur la permanence des pierres.
Alors, qui est-il, Julien Gracq ? Il est de la race des mages et des sorciers. On sent bien que s’il se remettait à écrire des romans, ce serait pour nous conter des histoires à la Tolkien dans un style aussi raffiné que celui de Marcel Proust. Alors il se garde bien de le faire et nous offre ici des aphorismes d’une grande clairvoyance sur l’art d’écrire : « les grands livres se mijotent dans des marmites de sorcières ». Lorsqu’il parle de l’économie propre au roman, Gracq utilise des termes et des formules empruntées à la physique newtonienne – électricité, étincelle, dynamique, mobile – pour conclure qu’il ne s’agit « en fin de compte, que d’une certaine vitesse initiale à atteindre. » Car celui qui aimait, comme il le raconte ici, sillonner les routes de l’Anjou et de la Normandie à bicyclette, savait que le roman est affaire d’endurance et de vitesse. Ni de musicalité, ni de sensualité, ni d’émotion, ni de vision ou de philosophie : il s’agit en fin de compte de produire une énergie durable et communicable. Le romancier serait ainsi une sorte d’entraîneur qui galvaniserait son lecteur ; s’il lui demande d’adhérer, ce n’est pas tant à une foi qu’à une sorte de moteur intérieur. On croirait parfois entendre Malraux nous rappeler que « la machine a changé le rapport de l’homme au monde qui n’a jamais connu pareille puissance d’imaginaire. » Et lorsque Gracq note que, « malgré les apparences, la littérature s’écrit en réalité à deux mains », nous qui pianotons nos textes des dix doigts, nous ne pouvons qu’acquiescer. On se prend un instant à rêver d’un Julien Gracq qui aurait apprivoisé l’ordinateur, le traitement de texte et les possibilités nouvelles que la technique offre au romancier. Cependant, comme il le note lui-même, il ignorait jusqu’à l’usage de la machine à écrire et les deux mains qu’il évoque ne sont pas celles du dactylographe mais du pianiste. Car il écrivait ses textes au fil de la plume, face à la basse continue de la Loire, tel un artisan soucieux de ne pas gâcher son talent. À une époque inquiète où nous perdons confiance dans la technique et retrouvons le sens du calme, c’est sans doute cela qui nous le rend si prodigieusement vivant.



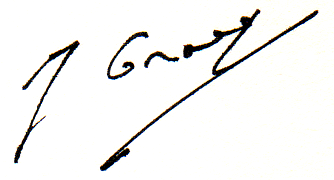

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F88%2F1119488%2F117990411_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F70%2F78%2F1119488%2F111695433_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F16%2F34%2F1119488%2F111696380_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F01%2F1119488%2F111467288_o.jpg)